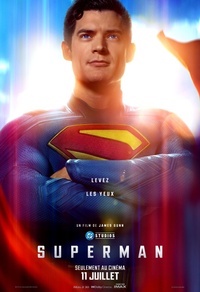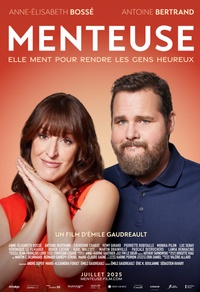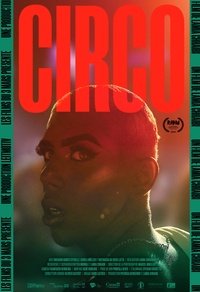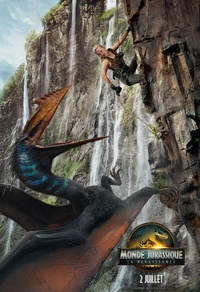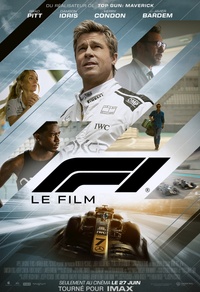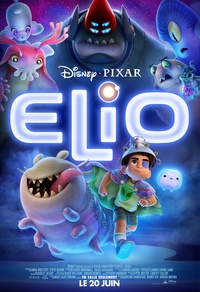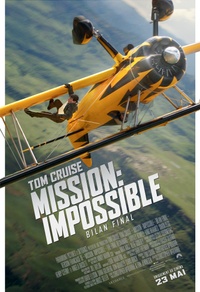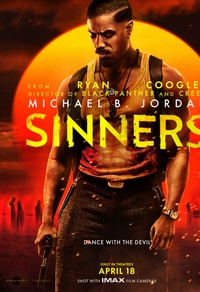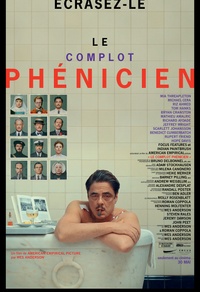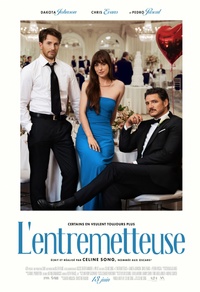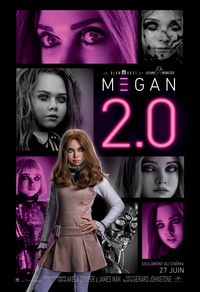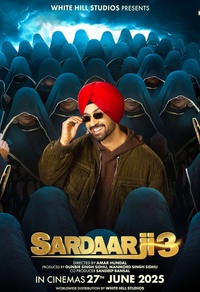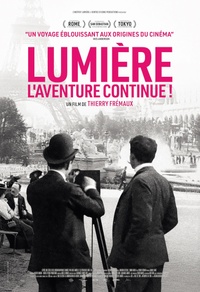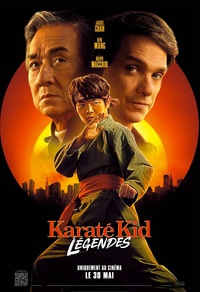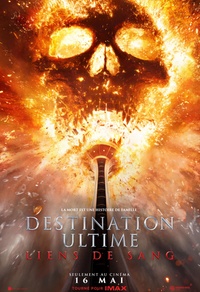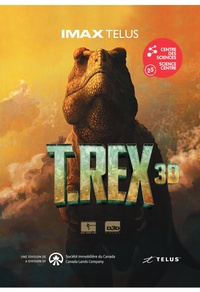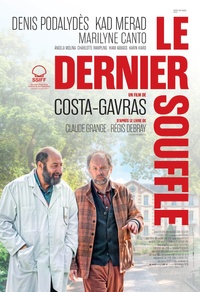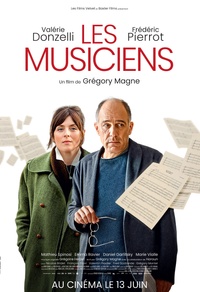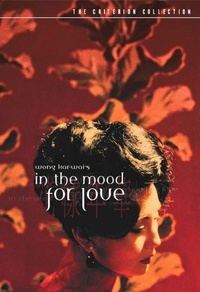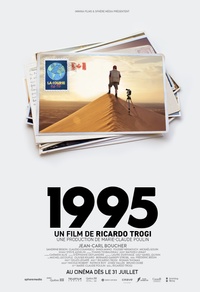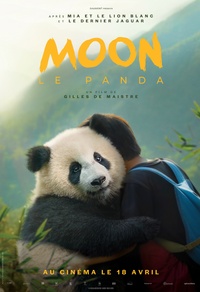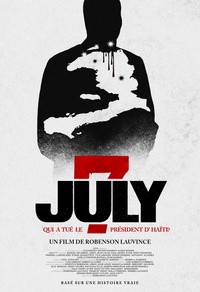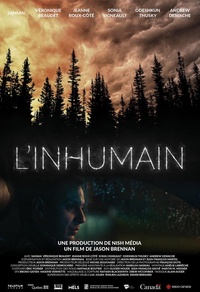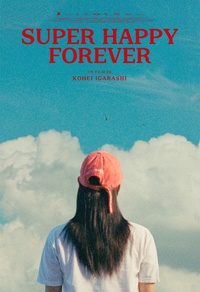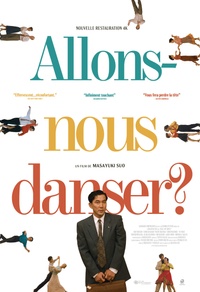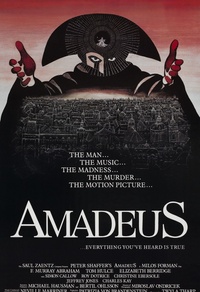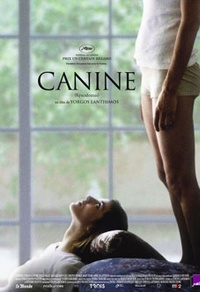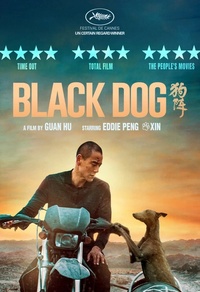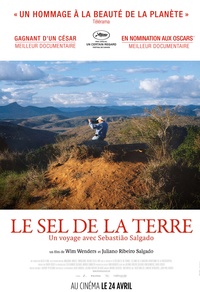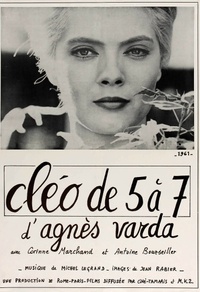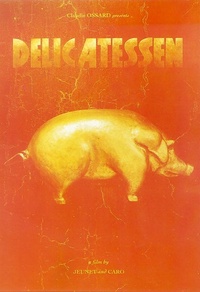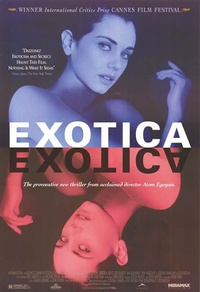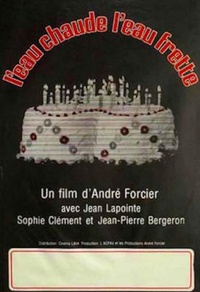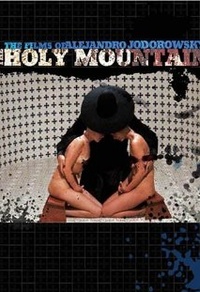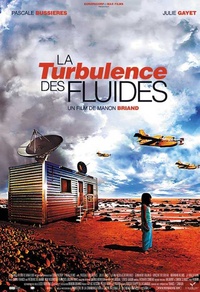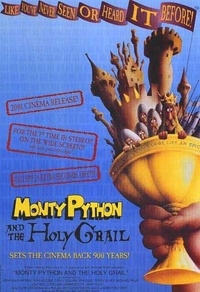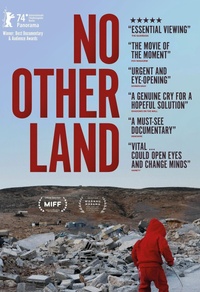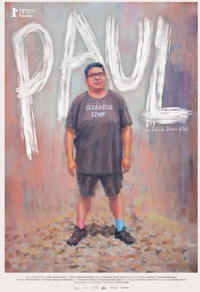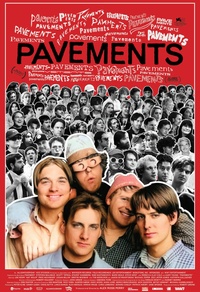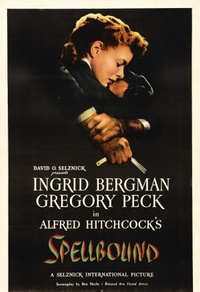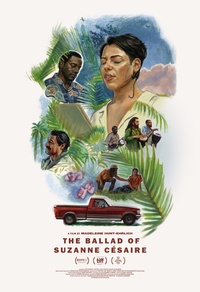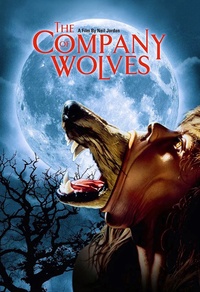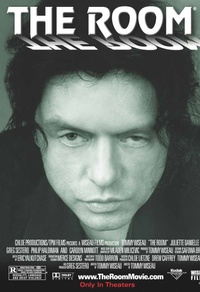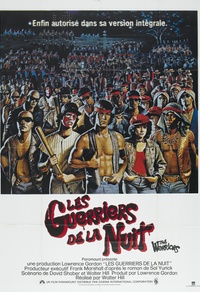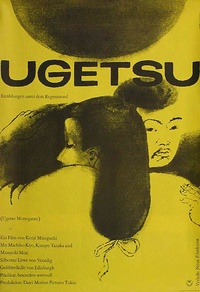Honte à moi. C’est, je pense, la première fois que ça m’arrive depuis un bon moment : je suis parti en plein milieu d’un film. Miracle at St. Anna, de Spike Lee, pour le nommer. Le film dure 160 minutes (2h40). Après une heure, je n’en pouvais plus tellement les idioties s’accumulent à un rythme affolant. Un commis de la poste qui regarde, plein de ressentiment, des films de John Wayne, porte toujours sur lui un fusil allemand de la Deuxième Guerre tant et si bien que, lorsqu’il doit s’en servir, il l’a justement à portée? Une Allemande qui parle de ses seins à la radio pour convaincre les soldats américains de se rendre? Un gros balourd un peu « cave » n’arrive pas à soulever une poutre mais peut lever d’un seule main le petit garçon qui est en-dessous parce qu’il a frotté une vieille tête de statue perdue depuis 400 ans? S’il y avait plus de murs dans les salles de cinéma, ça serait à se taper la tête dessus. Et puis cette manière ridicule, abrutissante et malhonnête, de montrer du racisme comme on montre des enfants malade à Vision Mondiale; c’était vraiment trop. Un navet, probablement le plus mauvais film de l’année (en ce qui me concerne, le pire demi-film). Est-ce que l’intention était bonne? On se souviendra surtout que Spike Lee avait reproché à Clint Eastwood de ne pas faire la bonne place aux Noirs dans ses films de guerre. Il est coupable du même péché : les Blancs, dans son film, sont tous de fieffés rednecks malintentionnés qui prennent plaisir à ne pas servir les Noirs au comptoir de crème glacée. Quand le seul argument qu’on trouve, c’est qu’ils ont servi des Allemands... Un autre film dont l’intention est bonne mais l’application plus difficile prendra l’affiche prochainement, le 3 octobre pour être précis : Religulous, ou en version française Relidicule, de Larry Charles (réalisateur de Borat). Mettant en vedette Bill Maher, humoriste athée particulièrement aride envers les croyances en général, le film ridiculise une à une à peu près toutes les religions imaginables, incluant la Scientologie. Très « punchée », la réalisation ne cesse de faire référence à la culture populaire avec des extraits de films qui sont, au départ du moins, assez amusants. Puis, le film tombe dans le piège du montage outrancier et manipulateur, qui associe – au profit d’une ligne éditoriale tracée d’avance – toutes les bêtises des religions... Mais les véritables bonnes entrevues menées par Maher, c’est-à-dire lorsqu’il ne se moque pas des faux prophètes qu’il rencontre, sont les premières négligées : les officiels de la religion catholique sont les plus lucides et les plus honnêtes du groupe, ne serait-ce que lorsqu’ils abordent des sujets délicats comme la science ou la richesse ostentatoire du Vatican.« Les grands récits »1 de Jean-François Lyotard et de sa Condition postmoderne auront une dure semaine; ces valeureux soldats qui sauvent la vie d’un enfant italien en pleine Deuxième Guerre mondiale se ridiculisent plus souvent qu’à leur tour, tandis que les religions, déjà méprisées, sont réduites à l’unique expression de leurs imposteurs. Le scepticisme actuel, qu’il faut nommer « postmoderne », n’acceptera pas, ne pourrait pas accepter ces films pour ce qu’ils voudraient pourtant être : des réquisitoires, des pamphlets destinés à être convaincants. On ne verra plus en eux que leur facilité à divertir, à faire écouler les minutes et à faire sourire un peu, soit par maladresse dans le cas du premier, ou volontairement dans le cas du second.
Et puis cette semaine sera l'occasion pour les uns et les autres de se traiter allègrement de racistes, antisémites, infidèles, dévots et de tu-vas-aller-en-enfer si, pour une raison ou une autre, on n'apprécie pas les films, si on ne sait pas faire la différence entre les qualités cinématographiques et la véracité du propos. Vraiment, c'est la semaine de la désillusion. 1. Selon Lyotard : « Ce qui se transmet avec les récits [la guerre et la religion en sont certainement les plus forts], c’est le groupe de règles pragmatiques qui constituent le lien social. » La condition postmoderne, Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 40.