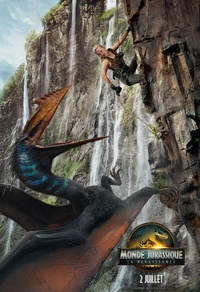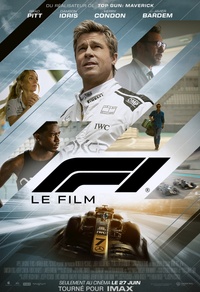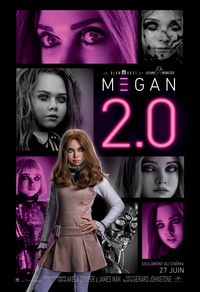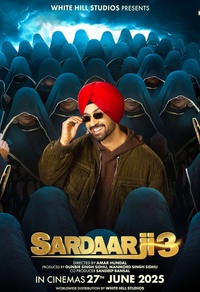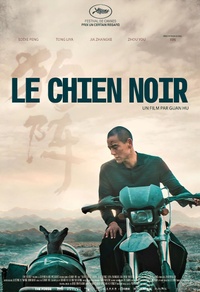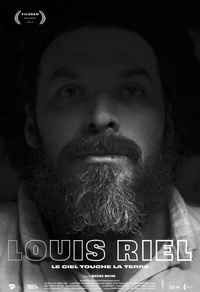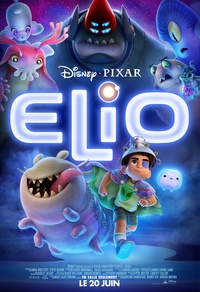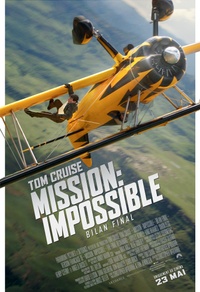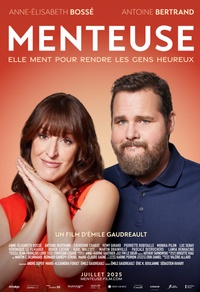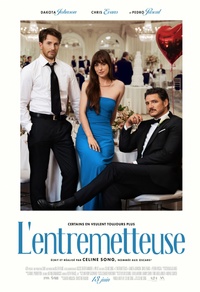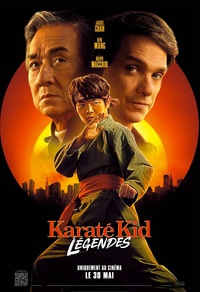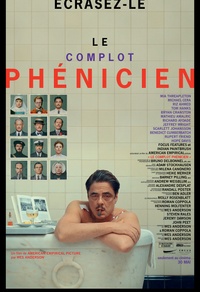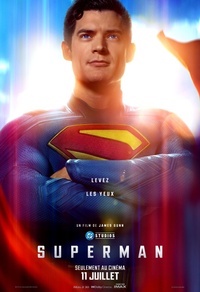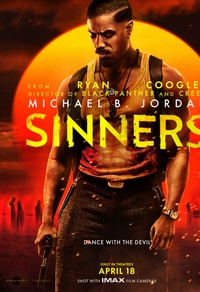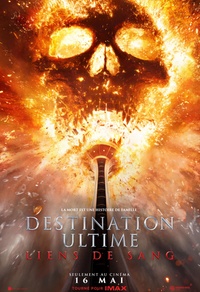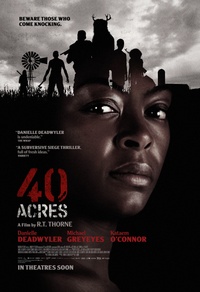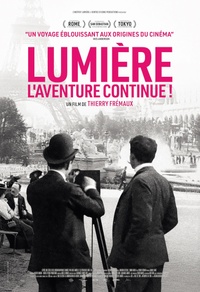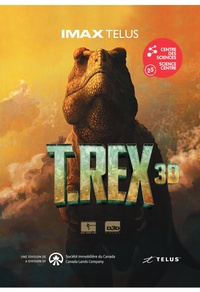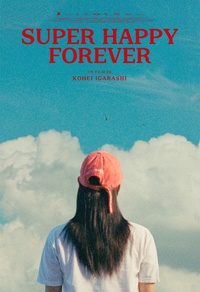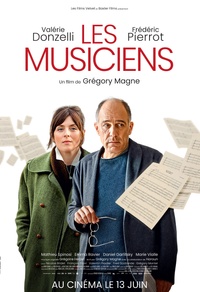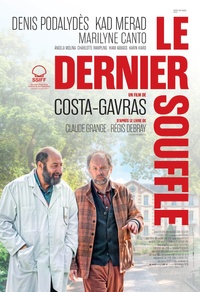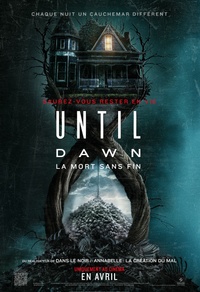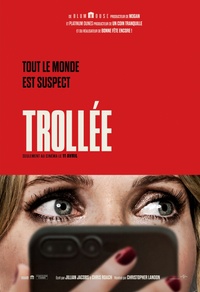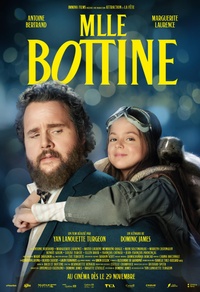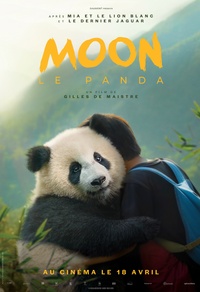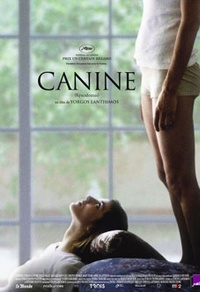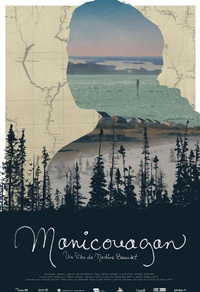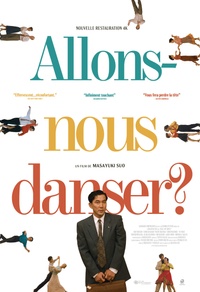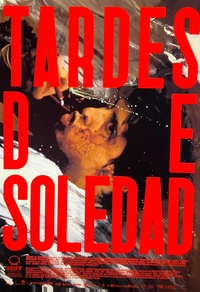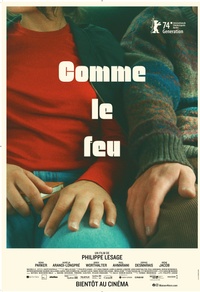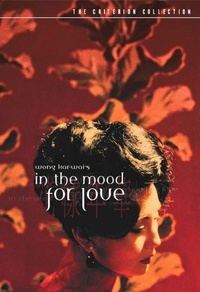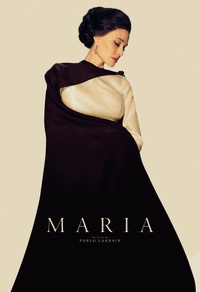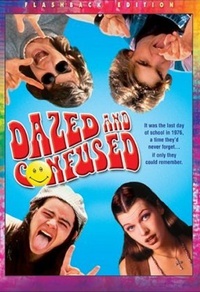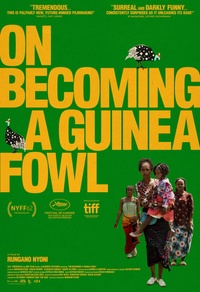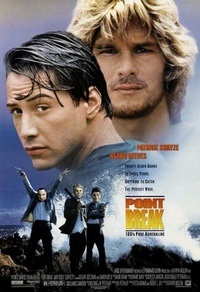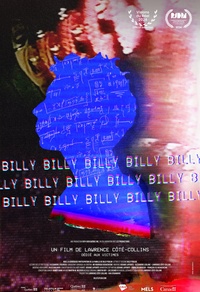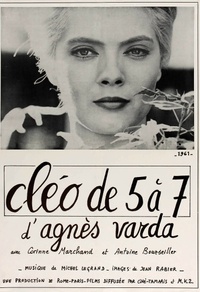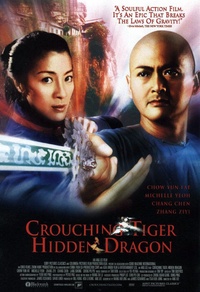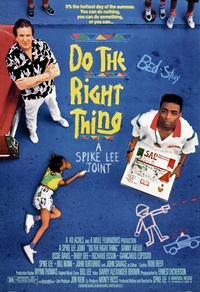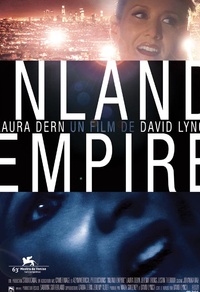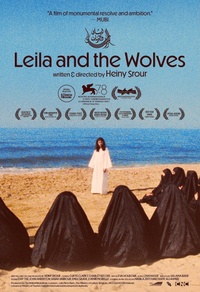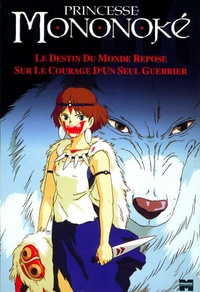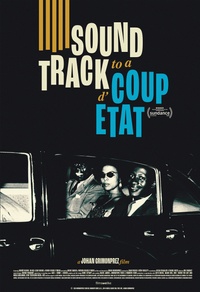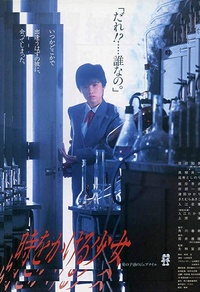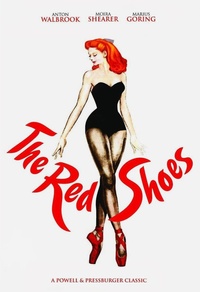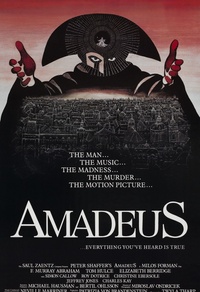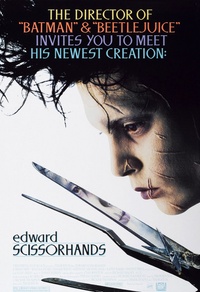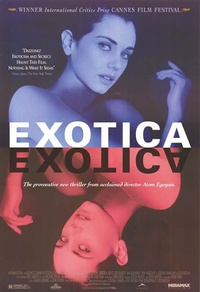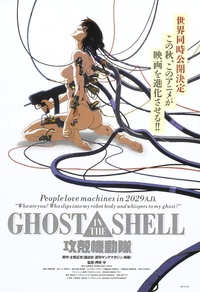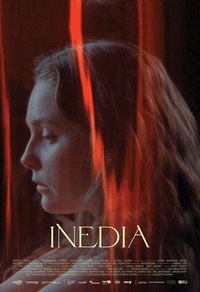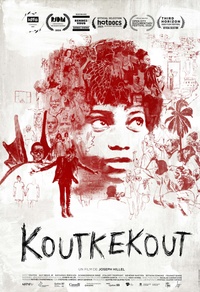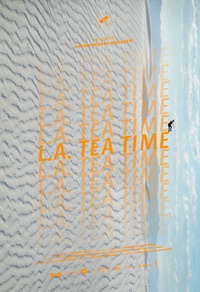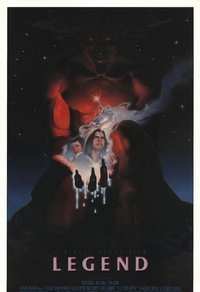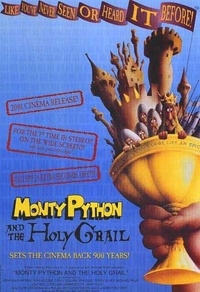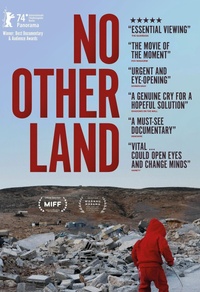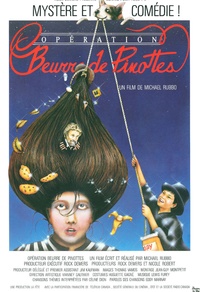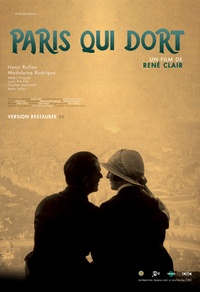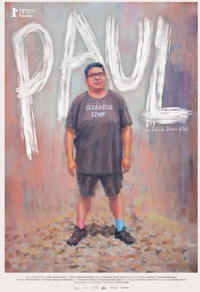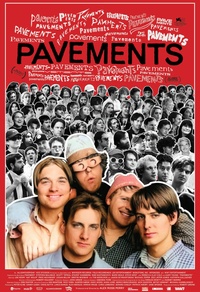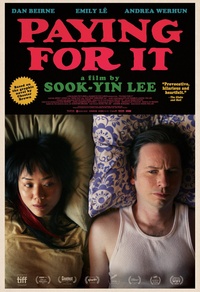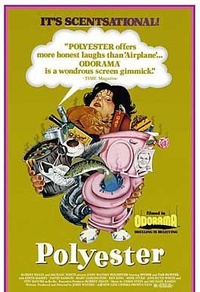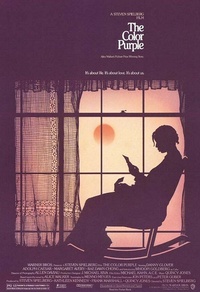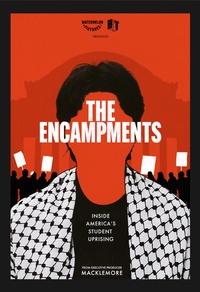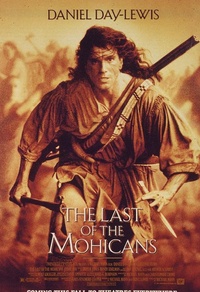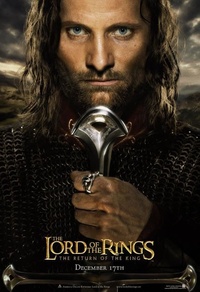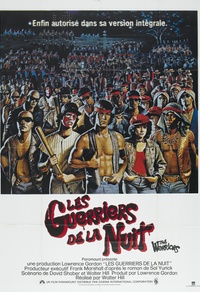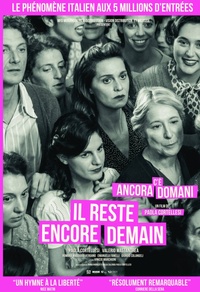Les artisans du film La ligne brisée ont rencontré les médias dans le cadre de la sortie du film, prévue ce vendredi. Lisez la critique du film ici.
Voyez notre galerie de photos de la première, en cliquant ici.
Guillaume Lemay-Thivierge et David Boutin ont dû subir un entraînement rigoureux pendant plusieurs semaines et devenir de vrais boxeurs. Avec l'aide d'Yvon Michel, ils ont ensuite recréé l'ambiance des combats et de l'entraînement, sous l'oeil attentif de la caméra de Louis Choquette.
Rencontre avec eux.
Guillaume Lemay-Thivierge On a beaucoup entendu parler de l'entraînement très rigoureux nécessaire au rôle dans le film. Pourquoi avoir accepté un rôle aussi exigeant? « Je serais menteur de ne pas commencer en te disant : le défi d’être un boxeur. Pour un acteur comme moi qui aime ça faire des affaires physiques, le défi est super excitant. En même temps, je commence à être stratégique. Je fais attention de ne pas jouer deux fois dans les mêmes axes. » Est-ce que ce rôle-ci ne ressemble pas un peu à celui de Nitro? « Cette fois-ci c’est encore très physique, mais il y avait quelque chose qui compensait énormément; c’est le côté très « deuxième personnage » dans sa tête. C’est un champion du monde, c’est un bon boxeur, mais il se sent deuxième. Il a un beau gros complexe d’infériorité qui est très intéressant à jouer. » « Quand j’ai vu le film pour la première fois, je me trouvais plate. Plus j’y repense, plus je me dis que non, c’était exactement ça, c’est ce que Louis voulait faire avec ce personnage-là. » Qu’est-ce qui fait un bon directeur d’acteurs? « C’est quelqu’un qui va avec ce que tu es. Un acteur, c’est comme une rivière, tu ne peux pas renverser le courant. Mais tranquillement, tu peux mettre des barrages pour le faire dévier, et même continuer à mettre des barrages pour espérer renverser le courant. Tu ne peux pas renverser d’un coup sec. » « Faut que tu sentes que le réalisateur a confiance en ton talent, en ton jeu. Une fois que c’est senti cette confiance-là, il peut t’emmener où il veut. C’est une relation d’amour dans le fond avec le réalisateur : tu veux lui plaire comme tu veux plaire à ton père et à ta mère. Tu essaies de frapper un circuit et tu regardes pour voir s’ils t’ont vu. » « Le réalisateur, c’est le yeux du public. Quand je joue, je ne pense pas à tout ceux qui vont le voir, les monteurs ou directeurs-photos, mais je veux savoir si le réalisateur est content. Si oui, parfait. »
Y a-t-il un rôle en particulier qui vous plairait? « J’aimerais ça faire une autre comédie, quelque chose de bien éclaté, quelque chose de gros. À la Louis de Funès, pratiquement. Olivier Guimond, des choses comme ça. Ou sinon, aller dans le très minimaliste, un drame qui se passe dans les yeux. Mais il ne faut pas que ça soit plate, il faut emmener le monde dans ton monde. » David Boutin « Moi ce qui m’intéressait d’emblée, c’est le défi de faire ça. C’est un défi physique d’acteur pour devenir crédible comme personnage. En plus, tu es payé pour te mettre en forme! » Qui est Sébastien Messier? « Ce n’est pas un gars sympathique d’emblée. C’est un gars qui va par plein de zones. Il passe de la fierté à l’amertume, c’est un gars qui a été ébranlé, qui est tombé et qui n’a jamais su comment se relever, et c’est ce qu’il cherche à faire. » Qu’est-ce qui fait un bon réalisateur? « J’aime quelqu’un qui est préparé, qui sait où il s’en va, qui a une ligne pour son film. Mais en même temps, s’il t’a choisi, c’est parce qu’il te fait confiance et qu’il est ouvert aux propositions. C’est lui qui donne la cohésion au film. » « Les scènes qu’on avait à faire sont très chorégraphiées, comme on a à les refaire souvent avec différents angles. Il faut que ce soit la même affaire pour ne pas que le monteur s’arrache les cheveux. » Et travailler avec Guillaume Lemay-Thivierge? « On avait la même rigueur par rapport au travail, on répétait tant qu’on ne l’avait pas. Et, quand la rigueur est là, la précision est là, même s’il y a un coup qui rentre un peu plus raide, c’est pas grave, ça fait partie de la game. » Louis Choquette Si vous pouviez recommencer, est-ce que vous agiriez différemment? « Je n’ai pas de regrets par rapport à ce film-là. Je suis quelqu’un qui doute beaucoup, j’angoisse pendant le tournage. Mais pour ce film-là, je peux dire que j’ai fait le film que je voulais faire. Ça a été très ardu comme tournage et comme production. Le processus est extrêmement laborieux. Ceci dit, au Québec c’est presque devenu un lieu commun de dire qu’on a fait beaucoup avec peu. » Même si c'est un premier film de ce genre au Québec, la boxe est probablement le sport le plus filmé au cinéma américain, et avec succès, souvent... « Le vrai sujet c’est de trouver les éléments, dans ce cas-ci l’aspect formel du tournage des combats, de trouver son style à soi, sa façon de raconter cette histoire-là. » « La première question que je me suis posée quand on m’a offert de faire ce film-là c’est : est-ce qu’il y a encore un film à faire sur la boxe? J’ai été longtemps dans un certain doute. Je n’étais pas moi-même un fan de boxe au départ, mais quand le sujet est arrivé on dirait que tout ça s’est estompé. Rapidement, on sortait des films de boxe pour nos références, pour nos styles de lumière, de couleur. » « On appelait La ligne brisée notre « film mexicain québécois. » Je suis en amour avec le cinéma mexicain, on avait des références avec la lumière de Cuarón, par exemple, et ce petit côté Y tu mama tambien, on est là avec eux dans une espèce d’hyper-réalisme. Je me suis amusé à cadrer à un certain moment dans le film, j’avais l’impression de vivre ça avec les personnages. » Est-ce que vos comédiens ont une qualité commune? « Ce que je leur demandais au départ, c’est d’avoir dans le spectre de jeu des zones où on pouvait presque aller chercher un autre personnage. Dany et Sébastien arrivent à un moment où ils sont confrontés à leurs démons, ils décident de les affronter et c’est la naissance d'un personnage à travers un autre. Après, c’est une question d’âge et de détermination pour l’entraînement. » « Il fallait aussi qu’ils soient de vrais boxeurs. » Maintenant, ce sera au public d’aller voir le film et de juger... « Mon rapport au film va commencer à changer un petit peu. On était dans une petite bulle depuis la fin du mixage du film jusqu’à aujourd’hui, où notre rapport au film n’est pas teinté de ce que les gens vont en dire ou en penser. Moi, je demande juste une chose, c’est d’en faire un autre. » Michelle Allen Pourquoi faire un film sur la boxe? « J’ai appris à m’intéresser à la boxe à cause d’Éric Lucas, en fait, quand il est devenu champion du monde. Je me suis rendue compte qu’il y avait un engouement, que les gens avaient un sentiment d’identification avec lui. Quand j’ai commencé à comprendre un peu plus le sport, j’ai vraiment eu une passion pour la boxe. » Quel aspect de l’histoire est arrivé le premier, l’accident ou la boxe? « La boxe. La boxe, parce que je trouve que c’est un sport de grands athlètes. Je trouve que c’est un sport de solitaire qui demande une détermination terrible. L’accident est venu comme révélateur, comme élément déclencheur de cette rupture. » Comment scénarise-t-on un combat de boxe? « Ça se scénarise en terme de narration. On veut savoir qui a le dessus, quand. C’est une courbe dramatique. Après j’ai travaillé avec Yvon qui m’a suggéré des combinaisons; mais de toute façon je commençais à assez connaître la boxe pour savoir que le vent tourne. Yvon a mis des mots là-dessus. Ça se scénarise autant qu’une scène dialoguée. » « Je trouve les combats très réussis. Et j’ai vu tous les films de boxe, là, et je pense qu’on peut être très fiers. » Yvon Michel Quand vous a-t-on impliqué dans le projet? « Avant d’écrire la première ligne. Il y a à peu près cinq ans, le producteur André Dupuy m’a appelé pour me rencontrer avec la scénariste Michelle Allen pour parler du milieu de la boxe. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai lu tous les scénarios que Michelle a écrits. Ils voulaient s’assurer de ne pas avoir une pré-conception du milieu de la boxe. » « On dit que les boxeurs sont des ignorants qui se font exploiter par leur gérant, qu’ils viennent de milieux défavorisés et qu’ils sont obligés de faire de la boxe pour survivre. Et qu’ils sont dirigés par les gens de la mafia. C’est les principaux clichés. » « Mais aujourd’hui, dans la boxe contemporaine, les gens qui font de la boxe et qui réussissent c’est parce qu’ils sont de grands athlètes. Joachim Alcine aurait pu jouer au basket-ball à un haut niveau, Éric Lucas aurait pu jouer au hockey, mais ils ont choisi la boxe. » « Aujourd’hui aussi c’est transformé, c’est les boxeurs qui exploitent leur promoteur! » Vous étiez donc très présent sur le plateau... « J’étais à toutes les étapes, même lors des présentations à la SODEC et à Téléfilm Canada. Ils voulaient que je sache ce que ça impliquait. Mais Michelle a été très très brillante, parce que les gens ont tendance à croire que tu peux prendre le style de Mohammed Ali pour boxer, mais chaque boxeur a son caractère, il faut que son style corresponde avec ce qui le fait fonctionner. Elle a compris ça. » Est-ce que l’entraîneur vous ressemble un peu? « Il ressemble à mon entraîneur, quand moi je boxais. Moi je serais plus de l’autre école. » « C’est très authentique. Les gens qui connaissent la boxe vont le voir. Il y a un film que je trouve très bon, Million Dollar Baby. L’histoire est belle, mais ce qu’ils ont fait avec la boxe, ça ne se tient pas du tout. Tu ne mets pas un banc sur le ring avant que la personne soit arrivée, tu ne frappes pas quelqu’un par terre, si ça avait été un vrai combat de boxe ça ferait longtemps que la personne aurait été disqualifiée. Pour leur film, eux, c’est correct, mais nous on a évité ça. » « Les comédiens n’ont pas « acté » à devenir boxeur. À la fin, ce ne sont pas des comédiens qui miment les gestes d’un boxeur, ils sont devenus de vrais boxeurs. Je suis très très fier de ça. »Le film prend l'affiche ce vendredi à travers le Québec.